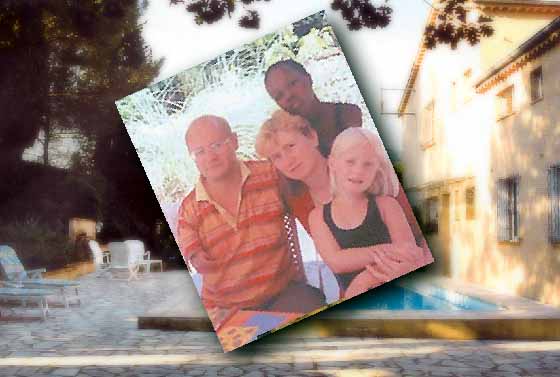Je suis né à terme le 28 novembre 1961, sans bras, et mon père raconte : « Quand Pierre est né, j’ai senti le sol se dérober sous mes pieds, je me suis senti basculer dans le vide et n’être plus de ce monde. J’avoue que j’ai souhaité qu’il ne vive pas. Si le diagnostic anténatal du handicap avait été fait, je crois que nous aurions penché pour une interruption de grossesse. A posteriori, je témoigne que l’IVG aurait été un immense gâchis. Mais à l’époque j’étais perdu, totalement désemparé. J’ai déambulé dans les couloirs. Il faisait nuit. Impossible de faire venir un orthopédiste ou un pédiatre. J’ai dit à ma femme que Pierre n’avait pas de petit doigt et elle s’est mise à pleurer. J’ai pris un somnifère, j’ai dormi en me réveillant sans cesse, croyant faire un cauchemar mais forcé de me rendre à la réalité. Le lendemain, j’ai présenté Pierre à sa maman. Le pédiatre ne se montra jamais durant le séjour à l’hôpital. L’obstétricien passait pour suivre l’évolution dans son domaine. Jamais il ne prit une minute pour parler de Pierre. Étant moi- même médecin, j’ai téléphoné à mes plus éminents professeurs qui sont tombés des nues : Pierre était un cas unique. J’ai appelé un ancien maître de stage en orthopédie, qui me parla de possibles reconstitutions d’humérus avec les péronés. Il me donna aussi les coordonnées d’un chirurgien spécialiste en revalidation, spécialement en prothèses du bras de valeur quasi égale aux vrais bras, parfaitement fonctionnelles et esthétiques ».
Évocation d’interventions chirurgicales hasardeuses, de prothèses miracles qui n’existent évidemment pas ou bien médecins demeurant invisibles et laissant « le sale boulot » aux infirmières : voilà encore aujourd’hui les témoignages de nombreux parents d’enfants handicapés. Il serait pourtant si nécessaire de déculpabiliser les parents, de les mettre rapidement en rapport avec d’autres familles ayant vécu le même drame, d’insister sur tous les atouts dont dispose l’enfant plutôt que de le réduire à sa déficience !
Chaque parent se sent coupable quelque part d’avoir « produit » un enfant handicapé: coupable vis- à- vis de lui- même car il reflète une image de soi tombée du piédestal (les psychologues évoquent une blessure narcissique), coupable vis- à- vis du conjoint (la mère pense qu’elle a mal travaillé, que ce n’est pas un tel enfant qu’elle voulait offrir à son mari) et enfin coupable vis- à- vis de la société qui est friande de nouveau- nés conformes au modèle dominant.
Après le deuil indispensable, la famille peut se réanimer en canalisant l’énergie versée dans les larmes vers un objectif altruiste. Sur le plan conjugal, mes parents ont cimenté leur couple dans un projet éducatif. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour développer le maximum des possibilités d’épanouissement que j’avais. Ainsi, j’ai suivi un enseignement normal et une kinésithérapie intensive qui m’a rendu plus fort et plus souple que bien des valides. J’ai pratiqué de nombreux sports, appris à parler de mon handicap comme quelque chose de normal, partie intégrante mais non exclusive de ma personne. Et sur le plan collectif, mes parents n’ont jamais cessé de témoigner, ils ont créé et développé l’association « Dysmélia », qui rassemble depuis presque 40 ans les personnes confrontées à la malformation des membres. Mes parents voulaient que j’arrive à vivre comme les autres, que je sois le plus autonome possible, que je ne devienne pas un poids pour la société, que j’obtienne la reconnaissance des autres dans la vie professionnelle, l’amour dans la vie sentimentale.
A 20 ans, j’ai épousé Martine, qui est valide mais connaissait la problématique du handicap puisque deux de ses soeurs sont porteuses de dysmélie. A 24 ans, j’étais licencié en Droit et ai alors exercé la profession d’avocat, sans bras… et sans manche ! Aujourd’hui nous avons quatre enfants, de 6 à 15 ans. Nous vivons près de Cannes où nous avons lancé un service d’accueil en chambres d’hôtes dans notre résidence.
Le bonheur n’est pas une question d’avoir des bras, de l’argent ou tout autre bien. Le handicap, comme toutes nos faiblesses et nos imperfections, peut servir de catalyseur pour mettre les valeurs dans le bon ordre. Que faut- il pour être heureux ? Il faut être aimé, reconnu tel que l’on est afin de s’assumer avec ses défauts et ses qualités. Fort de cette reconnaissance, on peut alors créer, oeuvrer pour laisser quelque trace positive de notre passage sur terre. Voilà ce que nous essayons de faire, Martine et moi, dans notre travail quotidien et dans notre rôle de parents. Nous avons concrétisé cette foi en notre expérience et notre bonheur en adoptant Muriel, porteuse d’un handicap que nous avions apprivoisé (amputation des bras et des mains) mais qui ne lui laissait aucune chance d’épanouissement dans son pays d’origine (Rwanda) et dans son milieu social ; pour nous, Muriel est née du ventre d’un avion le 11 janvier 1992. Elle est aujourd’hui bien intégrée en milieu scolaire « normal » et ne présente pas beaucoup plus de problèmes qu’un enfant dit « normal ».
Je voudrais enfin rapporter les propos que mon fils aîné, alors âgé de 3 ans, lorsque je lui demandais s’il était gêné d’avoir un papa handicapé. Sa réflexion répond à la quête de sens de tout un chacun, commun des mortels : « J’aime mieux un papa handicapé, parce que comme ça, je peux l’aider !«
Pierre Marcoux, février 2001
Note de la rédaction : Paul Marcoux, père de Pierre, a publié « Dans le regard des autres » aux Éditions du Centurion, collection Amour Humain. Ce livre est épuisé mais quelques exemplaires sont disponibles directement auprès de Pierre Marcoux.